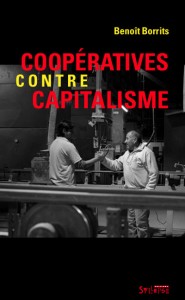 Pour développer l’emploi et l’économie locale
Pour développer l’emploi et l’économie locale
Pour développer les entreprises coopératives (SCOP) et l’économie sociale et solidaire
Pour augmenter les bas salaires sans alourdir le budget de l’État
Présentation d’une proposition de Benoît Borrits, dans le livre Coopératives contre capitalisme (Syllepse, 2015, 10 €). Cette proposition est résumée ici dans une version minimale qui, par ailleurs, peut connaître différentes extensions. Voir http://www.perequation.org .
L’idée de départ est de corriger en partie l’inégalité de la valeur produite (et gagnée sur le marché par l’entreprise) par salarié. En effet certaines entreprises produisent beaucoup plus de valeur par salarié que d’autres. C’est souvent le cas des grosses entreprises mais aussi de petites qui disposent d’une position dominante sur un marché. À l’opposé beaucoup d’entreprises produisent peu de valeur par salarié et sont donc réticentes à augmenter les salaires et à créer des emplois, et ce alors même qu’elles sont très utiles dans le tissu économique local. C’est le cas de beaucoup de PME et d’entreprises de l’économie sociale et solidaire.
La proposition est la suivante : tous les mois chaque entreprise cotiserait à un « pot commun » de toutes les entreprises à hauteur d’un pourcentage (par exemple 33 %) de la richesse qu’elle produit dans le mois, qu’on peut faire apparaître clairement dans sa comptabilité, comme nous le verrons. Cet argent serait réparti mensuellement à toutes les entreprises par péréquation à proportion du nombre d’emplois dans chaque entreprise (en équivalents temps plein) : chaque emploi autoriserait l’entreprise à recevoir une allocation égale, qu’elle pourrait utiliser pour financer une partie des salaires, ou créer de nouveaux emplois. En fait chaque entreprise donnerait, ou gagnerait, la différence entre ce qu’elle doit en cotisation et ce qu’elle reçoit en allocation. Les entreprises « riches » seraient contributrices : elles perdraient une partie de leurs bénéfices (mais elles peuvent se le permettre) ; à l’opposé, les entreprises « pauvres » seraient bénéficiaires et pourraient se maintenir (sans pour autant être payées à ne rien faire).
Une évaluation à l’échelle de la France montre que si la péréquation se fait sur 33% de la richesse produite, l’allocation par équivalent temps plein sera de 1326 euros. Ceci couvrirait une grande partie de ce que coûte un Smic à l’employeur. Voilà de quoi revenir sur les exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires, qui mettent en péril les budgets sociaux et incitent les employeurs à ne pas augmenter les bas salaires.
Comment mesurer « la richesse » produite par une entreprise ?
On peut le faire tout simplement en regroupant différentes colonnes de sa comptabilité mensuelle (voir p. 137 du livre) :
– d’un côté il y a les dépenses en achat de matériaux, entretien, loyers, impôts, machines et autres investissements, remboursement des crédits (principal + intérêts);
– de l’autre côté il y a les recettes de la vente des produits, les financements reçus et les subventions;
– et la différence entre les deux, autrement dit l’argent 1 à répartir entre les différents acteurs de l’entreprise (salariés d’une part, actionnaires propriétaires de l’entreprise d’autre part sous forme de dividendes et de fonds de réserve) représente la richesse monétaire produite par le travail de l’ensemble des employés (… et par l’intelligence des actionnaires dans leurs choix d’investissement).
En réalité, la richesse produite n’est pas seulement monétaire. L’activité d’une entreprise a toutes sortes d’effets concrets pour ses membres et pour la société, en positif (le lien social, l’entretien des qualifications, etc.) ou en négatif (la pollution surtout)… mais la comptabilité monétaire donne une mesure simplifiée de cette richesse et permet de la répartir. En effet, une partie de cette richesse est distribuée en salaires et cotisations sociales, une autre en dividendes versés aux actionnaires, une autre enfin est placée est servira pour les investissements ultérieurs 2. (Cette description est très simplifiée, en fait une partie de la richesse produite est transmise à la collectivité sous forme d’impôts, mais du point de vue de l’entreprise les impôts sont comptés dans les dépenses. De même on peut considérer que les intérêts des crédits sont une ponction sur la richesse produite par l’entreprise au bénéfice des actionnaires des banques, mais pour la comptabilité de l’entreprise le remboursement des crédits fait partie des dépenses.)
En pratique, le « pot commun » serait une institution de solidarité entre toutes les entreprises, une caisse obligatoire à l’image de notre sécurité sociale.
Tous les mois, les entreprises font leur calcul. J’ai demandé un exemple chiffré à Benoît Borrits, le voici :
– d’un côté la richesse disponible qu’a produit notre entreprise s’élève à 48 810 euros, nous devons donc payer au pot commun 33 % (ou 15 %, ou 45 % … selon ce qu’aura décidé le législateur) de cette somme, ce qui fera 16 107 euros ;
– d’un autre côté nous avons 15 salariés en équivalents temps plein, le pot commun nous doit donc 15 fois 1326 euros, soit 19890 euros d’allocations;
– dans cet exemple, notre entreprise sera bénéficiaire du système et recevra prochainement 19890 – 16107, soit 3783 euros qui proviendront des paiements immédiats des entreprises contributrices qui auront payé la différence entre ce qu’elle doivent et ce qu’elles sont censées recevoir au titre des allocations par personne employée.
Ce dispositif serait une bouffée d’oxygène permettant à de nombreuses entreprises de maintenir et de développer l’emploi, notamment pour répondre à des besoins qui existent, mais où les perspectives de bénéfices sont limitées ou incertaines, par exemple dans l’artisanat. On peut même penser que ce dispositif obtiendrait l’approbation d’une partie des patrons de PME.
Et tout cela sans qu’aucun budget public n’ait été sollicité !
Le « pot commun » inter-entreprises matérialiserait un intérêt commun entre les salariés des entreprises privées et ceux des Scop. Il deviendrait une conquête sociale pour ces salariés.
Ce « pot commun » est-il une utopie ? Oui, mais ni plus ni moins que ne l’étaient autrefois la Sécurité sociale, les caisses de retraite, l’assurance-chômage ! Peut-être qu’un jour, il sera présenté par des parlementaires déterminés…
Par ailleurs, la péréquation, en diminuant le chômage et en aidant les entreprises de main d’œuvre, pousserait à l’augmentation des bas salaires. Les défenseurs de la « rigueur » nous objecteront que tout ce qui tendrait à augmenter les revenus salariaux créerait un appel d’air pour l’achat de produits importés, donc risquerait de déséquilibrer le commerce extérieur – entre parenthèses, l’augmentation des dividendes distribués aux actionnaires a le même effet. A quoi on peut répondre que la péréquation en elle-même n’augmenterait pas automatiquement le total des salaires versés par les entreprises du pays. Mais il est vrai que de toute façon le risque d’augmentation des importations existe. Il faut donc y faire face par d’importantes relocalisations de la production. C’est un autre aspect des solutions économiques à mettre en œuvre.
Revenons à la péréquation. Financé par les entreprises qui en ont les moyens parce qu’elles gagnent beaucoup d’argent, ce dispositif serait une institution de justice sociale. Mais il n’empêcherait pas (si on limite la cotisation à 33 % de la richesse produite) les entreprises les plus performantes de gagner plus que les autres, donc d’attirer les investisseurs et de se maintenir. Il faut trouver un compromis entre la solidarité et d’autre part la compétitivité dans les conditions de la concurrence capitaliste.
On peut en effet discuter du pourcentage optimal de la cotisation. Ce serait un sujet de débat dans les grandes négociations sociales et au Parlement. Pour que l’allocation soit socialement et économiquement intéressante, il faut qu’elle représente un apport d’oxygène d’un niveau suffisant pour entraîner des créations d’emploi. Et pour cela il faut que la cotisation ne soit pas trop basse. Nous avons vu qu’une cotisation à 33 % dégagerait un niveau d’allocation de 1326 euros, permettant grosso modo à une entreprise qui a trois ou quatre salariés au Smic d’en embaucher un de plus. À l’opposé, si l’on ne veut pas démotiver les entreprises les plus performantes il ne faut pas que la cotisation soit trop haute. C’est pourquoi 33 %, voire 25 %, pourrait être un bon compromis. C’est un débat économique, mais aussi éthique et politique.
En tout cas l’existence du « pot commun » diminuerait les besoins de financement pour les entreprises « pauvres », et inversement inciterait les salariés des entreprises « riches » à se passer d’actionnaires extérieurs qui « siphonnent » la richesse créée. Dans les deux cas cela inciterait au passage en Scop (copropriété de ses salariés et sans actionnaires extérieurs).
Les coopératives et le capitalisme
La péréquation vise-t-elle à introduire une part de redistribution dans le fonctionnement du marché du travail capitaliste, ou à encourager et rendre possible une alternative au capitalisme ? Tous les deux ! La péréquation favorise la création d’entreprises de l’économie solidaire. Par exemple, pour des productions peu lucratives mais d’intérêt collectif, une municipalité ou une association de citoyens peut créer une SCIC (société coopérative d’intérêt collectif, en copropriété entre ses salariés et d’autres acteurs, par exemple une collectivité locale ou même une entreprise privée locale). De même, la péréquation facilite la création de Scop (ou la reprise en Scop d’entreprises qui ferment), y compris pour des productions peu lucratives ou pour des innovations pas encore lucratives. La péréquation est donc l’un des outils à mettre en œuvre pour le développement d’un secteur d’entreprises en propriété sociale, non capitaliste.
En effet, contrairement à ce qu’on croit souvent, les coopératives de production sont capables de supplanter les entreprises capitalistes. Et elles l’ont montré : c’est l’objet des premiers chapitres de Coopératives contre capitalisme, pleins d’exemples et faciles à lire. On y apprend que statistiquement les Scop ont une durée de vie plus longue et, à investissement égal, créent ou maintiennent plus d’emplois que les entreprises capitalistes. Ce malgré un environnement capitaliste qui ne leur est pas favorable, notamment les banques. La force des Scop réside dans la motivation et la cohésion des travailleurs, qui sont leurs propres patrons, qui ne sont pas soumis à des actionnaires extérieurs, et qui pratiquent une gouvernance démocratique de l’entreprise. Les Scop sont présentes aussi bien dans des secteurs exigeant de hautes qualifications, que dans des secteurs où beaucoup de salariés sont peu qualifiés, le bâtiment par exemple. Et dans ce cas les SCOP font plus d’efforts de formation et élèvent davantage la qualification de leurs employés que ne font les entreprises privées… Les Scop sont organisées en réseau (confédération générale au plan national, et unions régionales), ce qui est décisif pour la durabilité et l’adaptation des entreprises. Notamment le réseau des Scop a mis en place des fonds de financement qui donnent aux entreprises une certaine indépendance vis-à-vis des banques. Toutefois la France est moins avancée sur ce point que certaines régions d’Europe comme l’Émilie-Romagne en Italie, ou le Pays Basque et la Catalogne en Espagne.
On entend souvent dire en France que la forme coopérative ne convient qu’aux petites entreprises, mais en fait les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5000 salariés) sont tout autant présentes parmi les Scop que parmi les entreprises capitalistes (Borrits, 2015: 58). Certes, il n’y a pas de grande entreprise (plus de 5000 salariés) parmi les Scop en France, mais c’est le cas au Pays Basque espagnol où le groupe industriel Mondragon Corporacion Cooperativa fédère une centaine de coopératives dont une banque et une chaîne de grands magasins qui comptent parmi les plus grandes entreprises d’Espagne.
Bref, les Scop montrent qu’une alternative au capitalisme est possible par une prise en main démocratique de l’économie, et le livre de Benoît Borrits explore quelques pistes en ce sens. Un point clé à cet égard est le renforcement d’institutions de financement coopératives indépendantes des banques capitalistes.
Dans cette perspective, il faut tisser, plus qu’il n’en existe à présent, des liens de solidarité entre les salariés des entreprises capitalistes et ceux des Scop. À ce titre une grande partie du livre Coopératives contre capitalisme relate des expériences de lutte pour la défense de l’emploi par la reprise d’entreprises par leurs salariés sous forme deScop. Par exemple Fralib à Gémenos près de Marseille, que la multinationale Unilever voulait supprimer, est devenue SCOP-TI (Société coopérative provençale des thés et infusions) après trois ans de lutte. Dans ces expériences les travailleurs passent de la défensive à la lutte en positif pour une alternative.
C’est dans cette démarche que s’inscrit la proposition d’une péréquation de la richesse produite par les entreprises. Cette proposition ne résout pas tous les problèmes, mais si elle était défendue à l’échelle nationale par le mouvement syndical et d’autres mouvements sociaux, et par des élus au parlement, elle pourrait à la fois matérialiser un désir de solidarité qui existe dans la société, pousser au débat sur les réponses concrètes au chômage, et, si elle est adoptée, donner un sérieux coup de pouce au mouvement coopératif.
Notes:
- En termes de trésorerie il s’agit de ce que l’auteur appelle le « flux de trésorerie d’activité » qui est égal au flux de trésorerie net (Net cash flow) augmenté de la totalité de la masse salariale. Ce montant correspond à l’ensemble des flux de trésorerie générés par l’activité des salariés : salaires (individuels comme socialisés) + Net cash flow que s’approprient les actionnaires. ↩
- Cette description comptable vaut pour les entreprises capitalistes, mais aussi pour les Scop. Seulement dans une Scop il n’y a pas d’actionnaires extérieurs (ou seulement à un niveau limité), et les copropriétaires de l’entreprise sont les travailleurs eux-mêmes, égaux en tant que sociétaires (autrement dit citoyens de l’entreprise) avec une personne = une voix à l’assemblée générale. Les travailleurs d’une Scop reçoivent d’une part un salaire (avec les droits afférents, comme tous les salariés), et d’autre part une participation aux bénéfices (comme des actionnaires) qui est toutefois plafonnée car la finalité principale d’une Scop n’est pas le profit mais l’emploi et l’utilité de l’entreprise ↩














