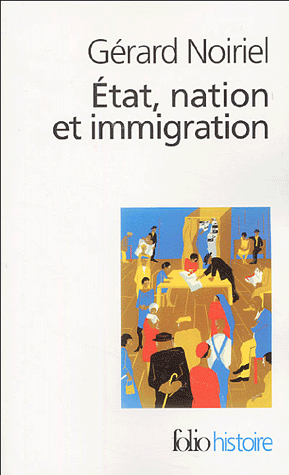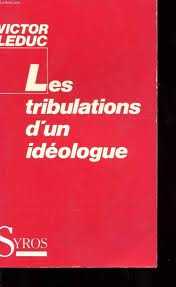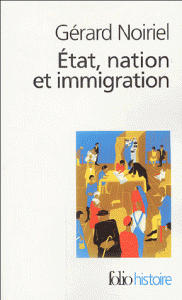 Le patronage et le paternalisme sont deux systèmes de contrôle de la main d’oeuvre développés par le patronat entre la fin du 19ème et le début du 20è siècles. Dans l’article « Du Patronage au paternalisme » l’historien Gérard Noiriel détaille leur fonctionnement, dans le cas de l’industrie lourde française. On y apprend comment une dépendance de plus en plus en plus grande des ouvriers par rapport à l’usine est instaurée. Dans une perspective autogestionnaire, cet épisode nous suggère aussi des pistes vers l’autonomie.
Le patronage et le paternalisme sont deux systèmes de contrôle de la main d’oeuvre développés par le patronat entre la fin du 19ème et le début du 20è siècles. Dans l’article « Du Patronage au paternalisme » l’historien Gérard Noiriel détaille leur fonctionnement, dans le cas de l’industrie lourde française. On y apprend comment une dépendance de plus en plus en plus grande des ouvriers par rapport à l’usine est instaurée. Dans une perspective autogestionnaire, cet épisode nous suggère aussi des pistes vers l’autonomie.
Le patronage
Dans la France rurale des années 1870, le métal est travaillé dans un grand nombre de départements, au sein de forges traditionnelles, artisanales et le plus souvent adossées à des exploitations agricoles. L’industrie lourde n’est qu’à ses débuts et compte très peu de grandes usines.
La main d’oeuvre est constituée d’ouvriers « externes » affectés aux tâches de manoeuvre, et d’ouvriers « internes » spécialisés dans la production proprement dite . Les externes sont des paysans venant chercher à la forge un revenu monétaire, alors que les « internes » vivent près de l’usine, tout en gardant une terre qu’eux-mêmes ou leurs femmes travaillent lors de temps morts de la production.
Le patronage, c’est d’abord un reste des « vieux usages ruraux » où le propriétaire dîne avec les ouvriers dont le statut est proche de celui des domestiques, et à qui il fournit à l’occasion des vêtements, de la viande, etc… Mais à mesure que se développent lentement les forges et que le besoin de disposer d’une main d’oeuvre stable se fait sentir pour assurer une production plus régulière, le patronage devient une stratégie de contrôle de la main d’oeuvre.
En effet, au début de la IIIème République, le rapport de force est favorables aux ouvriers, surtout spécialisés, en raison de la pénurie de main d’oeuvre qui handicape fortement l’industrialisation française, et met les patrons en difficulté par rapport à la concurrence internationale.
Dans ce contexte de « disette », le patronat explore différentes techniques de « fixation », et propose par exemple des terres à proximité des usines, en guise de sursalaire. Ceci permet d’une part de satisfaire l’ aspiration à la propriété de terre, et en même temps d’habituer dès l’enfance les futurs ouvriers à l’environnement et aux techniques industrielles. De plus, une grande autonomie dans l’organisation du travail et la gestion de la production est laissée aux ouvriers.
La crise et le paternalisme
Plusieurs effets se combinent à la fin du 19ème et plongent le modèle du patronage dans la crise :
- les procédés techniques sont révolutionnés, notamment grâce à l’application des découvertes et de la méthode scientifique.
- Le réseau ferré unifie le marché national.
- Des traités de libre-échange soumettent l’industrie française à la concurrence étrangère, notamment anglaise dans le cas de la métallurgie.
- La sidérurgie est mise en concurrence pour l’accès à la main d’oeuvre avec de nouveaux secteurs dynamiques et offrant un travail moins pénible.
En réaction face ces dangers, les patrons sont tenus de moderniser et d’augmenter la production : les usines se referment et se coupent de l’extérieur, l’autoritarisme patronal s’accentue, les ateliers se mécanisent et l’autonomie des ouvriers s’amenuise. Le lien avec le monde rural, autrefois stabilisateur, devient une entrave à la production.
Ces différents éléments conduisent les ouvriers et les patrons au conflit : de grandes grèves secouent l’industrie dans les années 1880. Les syndicats s’érigent en contre-pouvoirs, de nouvelles lois encadrent le travail (reconnaissance des accidents professionnels, statut juridique du salarié) et mettent le patronat sous pression.
Dans ce contexte, la mobilité des ouvriers s’accentue à la fin du 19ème : nombre d’entre eux quittent les grands centres de la métallurgie et se dirigent vers les nouveaux secteurs en développement : mécanique, électricité, mais aussi industries de transformation et services.
Au début du 20ème siècle, se met alors en place ce que les historiens nomment « paternalisme ». Le recours à l’immigration se développe, notamment via la Société Générale d’Immigration, qui permet de recruter le type de main d’oeuvre voulu et de l’orienter précisément en fonction des besoins. Cette pratique rompt avec celle de la phase précédent au cours de laquelle la main d’oeuvre nationale voire locale était privilégiée.
De plus un contrôle total sur la main d’oeuvre est organisé, qui prend de très nombreuses formes :
- les investissements d’infrastructure (logements, hôpitaux,…) sont pris en charge par les industriels, dans un premier temps pour répondre aux besoins non pourvus par l’Etat, puis dans un second temps pour occuper le terrain, y compris en bloquant l’initiative qu’elle soit publique ou privée. Les logements sont loués par l’employeur à ses salariés, et un régime de discipline parfois très strict est maintenu (visites régulières de gardiens).
- L’installation de commerces, de cafés, d’industries concurrentes est freinée, pour empêcher la diversification du marché du travail
- les bassins industriels sont maintenus dans l’isolement les uns des autres, pour éviter les fuites de main d’oeuvre et la « contamination syndicale ».
- Pour réduire encore le lien avec la terre, les femmes d’ouvriers sont incitées à suivre les cours d’écoles ménagères ouvertes par les patrons.
Point de vue autogestionnaire
G.Noiriel décrit donc dans cet article l’évolution des stratégies des contrôle, élaborées progressivement, par tâtonnements, par le patronat de la sidérurgie française pour résoudre les problème de stabilité et de qualification de la main d’oeuvre.
Mais quels enseignements en tirer d’un point de vue autogestionnaire ? Le chemin suivi par les paysans français depuis les champs jusqu’à l’industrie lourde est globalement celui d’une perte d’autonomie, corrélée à une augmentation du niveau de vie. Comment retrouver une autre forme d’autonomie tout en conservant le bénéfice des gains de productivités, des découvertes scientifiques et techniques (santé, transports, etc…) qui pour la première fois nous permettent de passer moins de temps au travail qu’en dehors du travail (cf Gorz sur le temps libéré) ?
Le premier enseignement serait peut être d’abord de rester vigilant face aux techniques de contrôle social décrites par Noiriel. Disposons-nous aujourd’hui d’outils adaptés pour les détecter, et surtout pour réagir ? Et quid des nouvelles techniques de contrôle social ?
On peut aussi remarquer que G.Noiriel cite Frédéric Le Play à de nombreuses reprises. Proche de Napoléon III, contre-révolutionnaire, ce précurseur de la sociologie, est souvent considéré comme un théoricien du paternalisme, reconnu pour la qualité de ses enquêtes de terrain et monographies.
Mais si Noiriel le cite, c’est pour s’associer à certaines de ses thèses plutôt propices à l’autonomisation des ouvriers du 19ème :
- importance de la pluri-activité, indépendance relative par rapport à l’usine, lien étroit avec à la terre.
- critique du rapport salarial, et du tout-monétaire.
- valorisation du travail non salarié (féminin notamment), qui fonde la « reproduction économique » de la société.
- importance du savoir pratique par rapport à théorie.
En allant plus loin, une image de l’usine souhaitable d’une point de vue autogestionnaire se dégage en négatif par rapport à l’évolution historique vers la grande usine intégrée de l’industrie lourde :
- un tissu d’usine distribuées géographiquement plutôt qu’un petit nombre de grands centres industriels.
- ouvertes sur la société plutôt que replié sur lui-même et coupé de la société.
- en prise avec le monde rural et l’environnement immédiat.
- Gérée et possédée par les travailleurs.
Livres
- Gérard Noiriel, « Etat, nation et immigration », Folio Histoire, 2001.
Web
- wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Noiriel
- blog http://noiriel.over-blog.com/